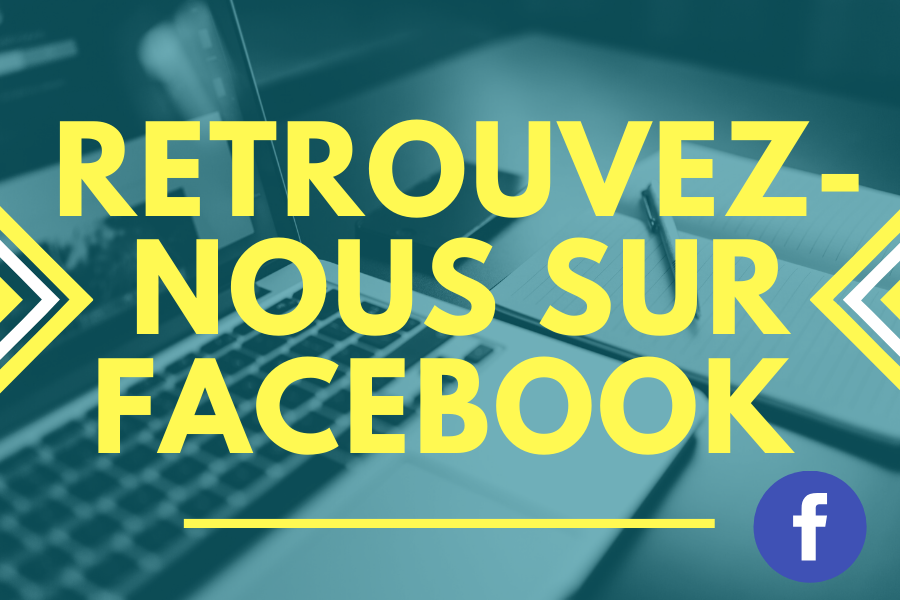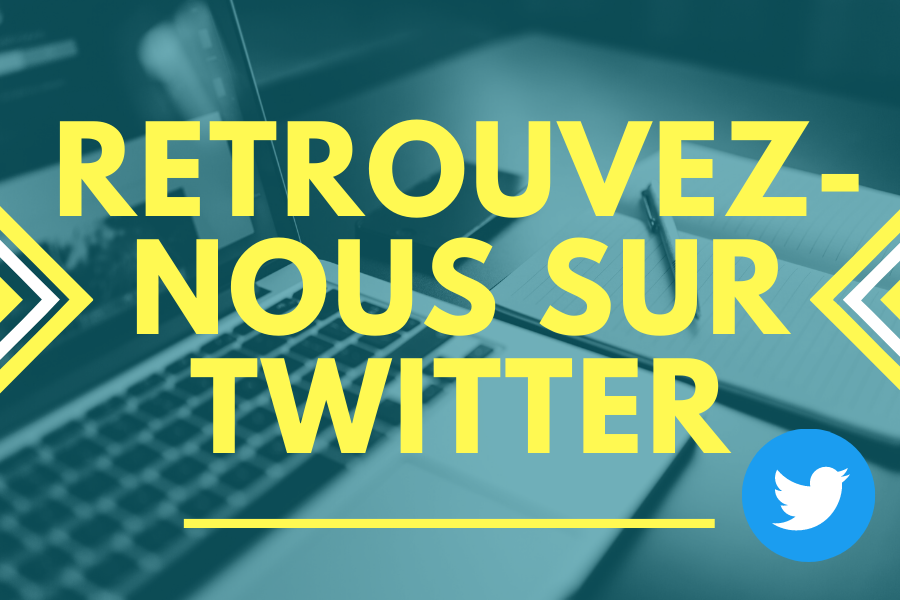- Accueil
- À Propos
- Journal l'Infobourg
- Campagnes
- Rue Saint-Jean
- Urgence d'occuper !
- 30 km/h dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste
- Rues partagées
- Patro Saint-Vincent-de-Paul
- Tourisme et Airbnb
- Coopérative d'habitation La Contrescarpe
- (Archives) Rues partagées : rue Sainte-Claire
- (Archives) Boucherie Bégin
- (Archives) Coopérative La face cachée
- (Archives) Défendons nos logements sociaux
- (Archives) Pédaler dans le quartier
- (Archives) Circulation de transit D'Aiguillon
- (Archives) Coop l'Escalier
- Nouvelles
- Soutien aux initiatives
- Documentation

Par Gabrielle Verret
Le 2 octobre dernier avait lieu une journée de mobilisation pour les groupes en défense collective des droits (DCD) ayant pour objectif de dénoncer les conséquences du sous-financement chronique auquel ils font face, ainsi que pour exiger un rehaussement de leur financement par l’entremise de trois grandes demandes en vue du budget de mars 2026.
Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale « Les droits, ça se défend collectivement » menée par les groupes membres du Regroupement des organismes en défense collective des droits. Durant toute la journée, les différents groupes et secteurs de la DCD ont présenté leurs missions, leurs enjeux et leurs préoccupations, avec comme point culminant une manifestation devant l’Assemblée nationale du Québec.
Qui sont les groupes en DCD ?
Au Québec, plus de 350 groupes en défense collective des droits (DCD) rassemblent des personnes et des collectivités confrontées à des injustices ou à des violations de leurs droits. Leur mission principale consiste à organiser des luttes collectives pour faire reconnaître et appliquer les droits de la personne, à dénoncer les pratiques discriminatoires et à améliorer les conditions de vie des personnes les plus pauvres et marginalisées. Ces organismes, qui jouent un rôle de véritables « chiens de garde » des droits sociaux et économiques, contribuent activement aux débats publics par l’analyse politique, l’éducation populaire, la mobilisation sociale et la représentation auprès des décideur·se·s. Leur action, ancrée dans l’approche de l’action communautaire autonome, a permis des avancées majeures comme la mise en place de programmes sociaux et l’amélioration de la législation québécoise. Depuis 2001, la Politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire du gouvernement du Québec reconnaît officiellement leur apport essentiel à la vie démocratique et les finance par le programme « Promotion des droits » du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) relevant du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Ce soutien institutionnel, paradoxalement octroyé par l’État aux organismes qui critiquent ses propres politiques, illustre la singularité et la richesse du mouvement québécois de défense collective des droits.
Pour être reconnus et financés, les groupes en DCD doivent répondre à 12 critères :
1. Statut d’organisme à but non lucratif (OBNL)
2. Enracinement dans la communauté
3. Vie associative et démocratique
4. Autonomie et liberté de déterminer sa mission, ses orientations, ses approches et ses pratiques
5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté
6. Poursuite d’une mission qui favorise la transformation sociale
7. Pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité des situations problématiques abordées
8. Conseil d’administration indépendant du réseau public
9. Éducation populaire autonome
10. Action politique non-partisane
11. Mobilisation sociale
12. Représentation politique auprès des élus et élues d’instances publiques et privée
Quelles sont les trois grandes revendications des groupes ?
Alors que les politiques néolibérales et les coupes dans le système public d’éducation et de santé aggravent les inégalités, les groupes en DCD, l’un des derniers remparts pour plusieurs personnes qui sont dans des situations de précarité extrême, sont eux-mêmes touchés par les politiques austères des gouvernements. Ces groupes, parmi les moins bien financés du communautaire, peinent à accomplir leur mission faute de ressources suffisantes, sans indexation depuis plusieurs années et avec des équipes surchargées et mal rémunérées. Pour renverser cette tendance, trois revendications majeures sont mises de l’avant :
- Accorder 155 millions de dollars supplémentaires par année pour soutenir adéquatement la mission de l’ensemble des groupes déjà financés, en incluant les coûts liés à la participation des personnes en situation de handicap ;
- Instaurer un mécanisme permanent d’indexation basé sur l’indice des coûts de fonctionnement du communautaire, ce qui représenterait 3,6 % pour 2025-2026 ;
- Mettre en place un processus transparent permettant d’accueillir de nouveaux groupes, en leur consacrant une enveloppe budgétaire permanente.
Pourquoi revendiquer un financement à la mission ?
Les groupes en défense collective des droits revendiquent un rehaussement de leur financement à la mission parce qu’ils font partie des organismes communautaires les moins bien soutenus financièrement et qu’ils s’appauvrissent d’année en année, notamment depuis la perte de leur maigre indexation de 1 %. Le financement à la mission est vital : il reconnaît l’importance de leur rôle, assure une certaine autonomie et exige une reddition de comptes allégée, contrairement au financement par projet ou par entente de service, qui sont ponctuels, contraignants et orientés par les priorités gouvernementales. Sans un financement à la mission adéquat et stable, les groupes en DCD doivent multiplier les demandes de projets incertains, ce qui fragilise leur capacité d’agir collectivement, surcharge les équipes et les éloigne de leur véritable mandat : défendre les droits et lutter contre les inégalités.

 Facebook
Facebook Google+
Google+ LinkedIn
LinkedIn Twitter
Twitter