- Accueil
- À Propos
- Journal l'Infobourg
- Campagnes
- Rue Saint-Jean
- Urgence d'occuper !
- 30 km/h dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste
- Rues partagées
- Patro Saint-Vincent-de-Paul
- Tourisme et Airbnb
- Coopérative d'habitation La Contrescarpe
- (Archives) Rues partagées : rue Sainte-Claire
- (Archives) Boucherie Bégin
- (Archives) Coopérative La face cachée
- (Archives) Défendons nos logements sociaux
- (Archives) Pédaler dans le quartier
- (Archives) Circulation de transit D'Aiguillon
- (Archives) Coop l'Escalier
- Nouvelles
- Soutien aux initiatives
- Documentation
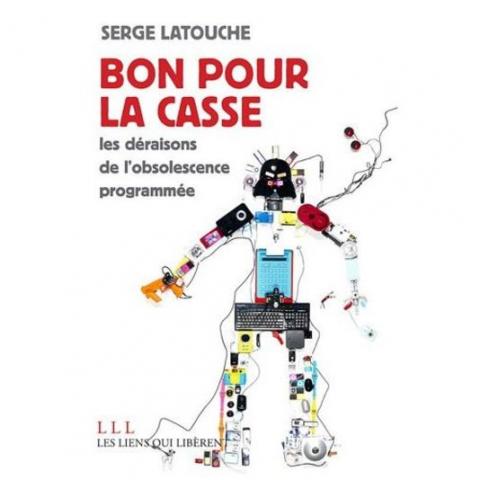
Par Andrée O’Neill Toutes celles et ceux qui ont vu, ou revoient parfois, La petite vie, l’une des meilleures séries de l’histoire de la télé québécoise, ne peuvent oublier Popa et ses vidanges. Popa qui protégeait jalousement le contenu de ses sacs verts et piquait une crise si quiconque s’avisait d’y toucher. La Petite Vie, c’était il y a 25 ans. En 2018, on pourrait se demander si Popa, dans le fond, n’avait pas pressenti mieux que tout le monde la crise écologique qui est à nos portes. Peut-être que s’il chérissait à ce point ses vidanges, c’est qu’il les voyait comme des ressources plutôt que des détritus sans valeur ? Peut-être s’arrêtait-il tout simplement à réfléchir à l’absurdité de notre économie linéaire et de notre culture du « jeter après usage » ? Cette réflexion, c’est un peu ce que nous suggère Bon pour la casse, les déraisons de l’obsolescence programmée (1). Son auteur, Serge Latouche, y remonte le fil de l’histoire récente du capitalisme industriel pour expliquer ce phénomène que nous vivons tous, parfois de notre plein gré – le iPhone7, c’est tellement 2016 ! – parfois dans l’impuissance ou la révolte (l’imprimante qui vous lâche ou la machine à laver moins chère à remplacer qu’à réparer). Malgré des références et un vocabulaire destinés avant tout à un public européen, Bon pour la casse trouvera une résonance chez la grande majorité des consommateurs et consommatrices de ce côté-ci de l’Atlantique. Serge Latouche retrace, dans un premier temps, les événements précurseurs de l’obsolescence programmée, en particulier celui qui va donner forme au concept : au début des années 1920, les acteurs majeurs du marché des ampoules, réunis à Genève, s’entendent pour limiter la durée de vie de ces objets de première nécessité, à leurs yeux beaucoup trop longue, et forment ce qu’on appellera le « cartel des ampoules » (2). C’est ce que Serge Latouche définit comme l’obsolescence technique. Par la suite, au cours de la décennie 1930, l’industrie de l’automobile va tracer la route de manière encore plus décisive à l’obsolescence, mais psychologique cette fois. Alfred Sloan, designer et responsable de la section Chevrolet chez General Motors, veut s’attaquer au monopole de Henry Ford et de son modèle T. Sachant qu’il peut difficilement battre Ford sur le terrain de la performance et de la robustesse, il décide de lancer chaque année un nouveau modèle avec peu ou pas d’innovations techniques, mais de petits changements dans la forme et l’apparence. Par son génie du marketing, il réussit à persuader le peuple américain de changer d’auto tous les trois ans, juste le temps qu’il faut pour rembourser l’emprunt de la précédente. Alfred Sloan et GM iront même jusqu’à rendre obsolète l’aménagement même de nombreuses grandes villes nord-américaines, en achetant puis en démantelant leurs réseaux de tramways, afin que leurs rues puissent accueillir plus de voitures. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, les décideurs économiques et politiques constatent que l’effort de guerre, par la production intensive d’armements et de fournitures, a permis de juguler la dépression des années 1930 et de renouer avec la croissance. Ils avaient trouvé la recette miraculeuse de la prospérité : la production de masse, infinie et constante ! Mais pour écouler cette production, il fallait une demande, tout aussi infinie et constante. Une paire de bas ou un malaxeur qui durent vingt ans, ça ne peut qu’empêcher l’économie de rouler, et ça n’est surtout pas rentable pour un fabricant. C’est là qu’entrent en jeu les mécanismes qui nous ont progressivement rendus, comme le dit Serge Latouche, « toxico-dépendants » à la surconsommation. Les spécialistes de la communication et de la publicité se mettent alors sérieusement à la tâche pour nous pousser à transformer notre conception des ressources, à plus ou moins dévaloriser l’épargne et à nous tourner sans retenue vers le crédit. C’est à ce moment que la consommation de masse prendra son envol et que l’addiction à la croissance deviendra l’essence de notre économie capitaliste. Il faudra tout de même encore beaucoup de temps avant que la durée de vie des objets de notre quotidien atteigne les records de brièveté d’aujourd’hui. Tout le monde a entendu parler d’un frigo des années 50 encore fonctionnel, ou de l’aspirateur à skis de nos grands-parents qui n’a jamais défailli. On peut dire que c’est surtout avec les décennies 1980 et 1990 et la financiarisation de l’économie, qui allait propulser la course aux profits à des niveaux stratosphériques, que l’idéologie du jetable s’est imposée dans les esprits. C’est l’exploit qu’ont accompli les experts et expertes du marketing et de la « persuasion clandestine » : travestir la déraison en raison et nous faire voir comme rationnels des comportements qui nous mènent au suicide collectif. Dans un deuxième temps, Serge Latouche se penche sur les implications morales de l’obsolescence programmée, et jette un regard à la fois pessimiste et optimiste sur l’avenir de notre civilisation capitaliste. L’obsolescence programmée, dit-il, est un cul-de-sac économique et culturel, et elle atteindra tôt ou tard ses limites. Il salue la résistance qui s’organise un peu partout dans le monde (on n’a qu’à penser au groupe Touski se répare et aux autres Fab Labs), une résistance nécessaire mais insuffisante, qui devra impérativement s’accompagner d’une « décolonisation des esprits » et d’une transition vers la décroissance. Les bouleversements climatiques et la destruction des écosystèmes vont nous forcer, un jour ou l’autre – du moins l’espère-t-il – à nous recentrer sur l’essentiel pour construire une économie circulaire et durable. Selon les spécialistes de la paléontologie, toutes les espèces sont programmées pour s’éteindre au bout d’un certain temps, crise écologique ou pas. Ça vaut aussi pour les humains, à qui il resterait environ 200 000 ans avant de devenir des fossiles et de faire de la place à d’autres formes de vie. Mais ça, c’est un scénario vraiment très, très optimiste. 1- Serge Latouche, 2012, Bon pour la casse, les déraisons de l’obsolescence programmée, Paris, Éditions Les liens qui libèrent, 100 pages. 2- D’où le titre du film The Lightbulb Conspiracy, (en français Prêt à jeter), de Cosima Dannoritzer, tiré d’un livre dont Serge Latouche devait au départ écrire la préface. Autres films à voir sur le sujet : La poubelle province, de Denis Blaquière, et The Story of Stuff, d’Annie Leonard, accessibles en ligne.

 Facebook
Facebook Google+
Google+ LinkedIn
LinkedIn Twitter
Twitter


