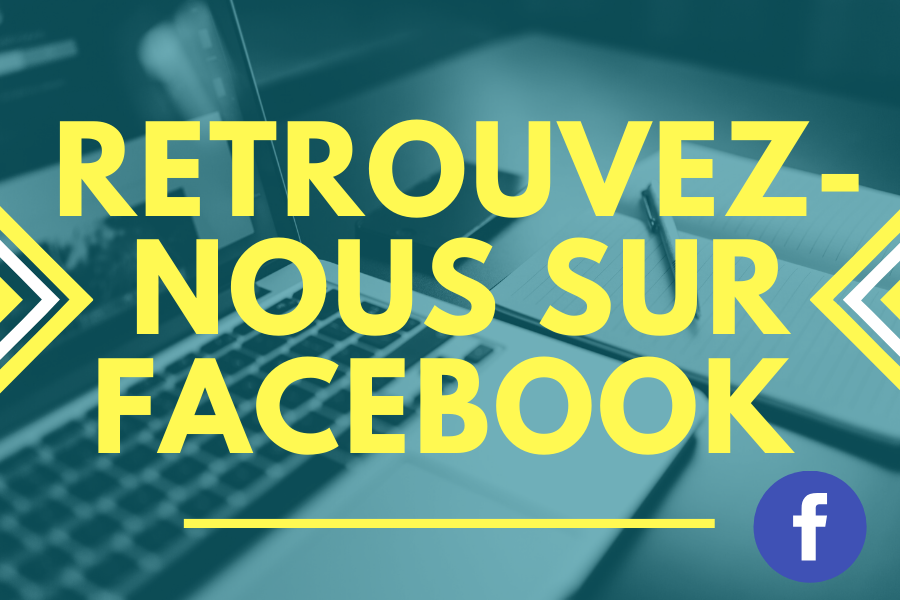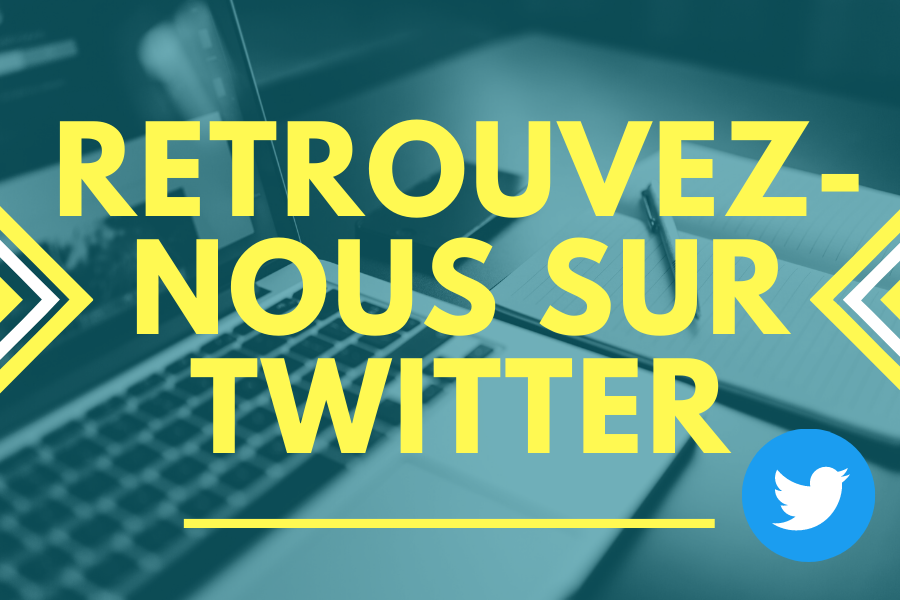- Accueil
- À Propos
- Journal l'Infobourg
- Campagnes
- Rue Saint-Jean
- Urgence d'occuper !
- 30 km/h dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste
- Rues partagées
- Patro Saint-Vincent-de-Paul
- Tourisme et Airbnb
- Coopérative d'habitation La Contrescarpe
- (Archives) Rues partagées : rue Sainte-Claire
- (Archives) Boucherie Bégin
- (Archives) Coopérative La face cachée
- (Archives) Défendons nos logements sociaux
- (Archives) Pédaler dans le quartier
- (Archives) Circulation de transit D'Aiguillon
- (Archives) Coop l'Escalier
- Nouvelles
- Soutien aux initiatives
- Documentation
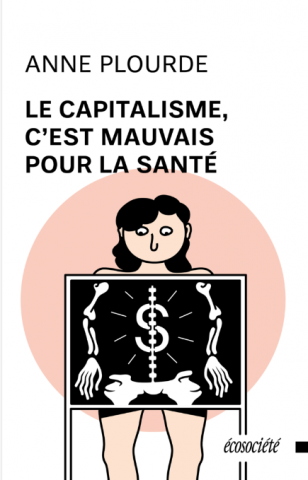
Par Andrée O’Neill
Notre système de santé craque de partout, mais ce n’est peut-être qu’un avant-goût de ce qui nous attend si nous ne réussissons pas à freiner les changements climatiques – ce qui malheureusement semble désormais un objectif hors d’atteinte. Nous sommes parti·e·s pour faire face à des bouleversements sans précédent : économiques, sociaux mais surtout sanitaires. Et l’économie capitaliste qui est la nôtre depuis des siècles fait tout pour nous préparer le plus mal possible à cette menace sur nos soins de santé.
Au Québec pourtant, au début des années 70, nous avons posé les bases d’un des modèles de services de santé les plus avant-gardistes en Amérique du Nord. Le gouvernement libéral de Robert Bourassa a d’abord implanté un régime public et universel (ou presque) d’assurance-maladie à l’automne 70 puis, quelques mois plus tard, a mis sur pied le réseau des CLSC ou Centres locaux de services communautaires, fortement inspirés de ce que les membres de la Commission Castonguay-Nepveu, en tournée en Europe pour étudier cette question, avaient vu en Tchécoslovaquie (un des pays satellites de l’URSS à cette époque) : une première ligne forte, centrée sur la prévention et sur une approche multidisciplinaire qui prend en compte l’environnement socioéconomique des personnes soignées. Tout le contraire d’une médecine de soins curatifs, de médicaments et de systèmes hospitaliers.
Mais c’était sans compter la résistance des milieux d’affaires, des chambres de commerce, des compagnies d’assurance et particulièrement des médecins (qui, faut-il le rappeler, s’étaient massivement opposés à l’adoption de la Loi sur l’assurance-maladie en 1970). Dès le milieu de cette même décennie, une contre-offensive s’est amorcée contre la « médecine communiste » et pour le retour du « bon docteur, de l’hôpital et du pilulier ».
C’est ce que nous relate Anne Plourde, chercheuse à l’Université York et à l’Institut de recherche et d’information socioéconomique, dans Le capitalisme, c’est mauvais pour la santé. Coupes dans les services et le personnel, démantèlement progressif des CLSC, rémunération disproportionnée accordée aux médecins, tout a été fait pour que la médecine redevienne une occasion d’affaires.
La santé est un enjeu politique, mais le capitalisme dépolitise cet enjeu, par exemple lorsqu’on nous enjoint d’adopter de « saines habitudes de vie », alors que notre environnement (physique, économique, social) nous en empêche ; ou lorsqu’on nous persuade − de plus en plus souvent depuis au moins une quinzaine d’années − que payer de notre poche pour avoir accès à des soins ou des examens est la seule solution possible pour préserver notre santé.
C’est dans l’essence même du capitalisme de générer des inégalités économiques et des conditions de vie qui détériorent tant notre santé que celle de la planète, car c’est ce qui le fait rouler jusqu’à maintenant.
Peut-être serons-nous tenté·e·s, la prochaine fois que notre médecin (si on a la chance d’en avoir un, bien sûr), nous vantera les bienfaits du régime méditerranéen, de l’activité physique ou de la cessation du tabagisme, de lui suggérer la lecture de cet ouvrage pour le ou la convaincre qu’il n’y a pas que les gras trans, la cigarette ou la sédentarité qui sont mauvais pour notre santé.
Anne Plourde, Le capitalisme, c’est mauvais pour la santé, Éditions Écosociété, 2021.

 Facebook
Facebook Google+
Google+ LinkedIn
LinkedIn Twitter
Twitter